Interview de Patrick Bauwen (02/02/2007)
Au milieu de l'ambiance sympathique et conviviale du festival de polar de Saint-Quentin en Yvelines, Patrick Bauwen a répondu à quelques questions pour Polars Pourpres. Une interview au cours de laquelle Patrick revient sur la conception de L'Oeil de Caine et sur sa définition d'un bon page-turner.
 Nicolas : Bonsoir Patrick. Peux-tu commencer par te présenter à tous ceux qui ne connaissent pas encore l'auteur de L'Oeil de Caine ?
Nicolas : Bonsoir Patrick. Peux-tu commencer par te présenter à tous ceux qui ne connaissent pas encore l'auteur de L'Oeil de Caine ?
Patrick Bauwen : Je m'appelle donc Patrick Bauwen, j'ai 38 ans, marié, 2 enfants. Je suis médecin urgentiste et responsable d'un service d'urgences de région parisienne. Et, à mes heures perdues, je suis écrivain.
N. : J'ai appris que tu avais t'étais lancé dans l'écriture en rédigeant des scénarios de jeux de rôle pour Casus Belli dans les années 90, et des novellisations (Lanfeust de Troy notamment) au début des années 2000. Comment as-tu sauté le pas pour écrire ce premier thriller ?
P. B. : En fait, j'écris depuis très longtemps, depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'ai toujours eu envie d'écrire des histoires. Un de mes premiers flashes, quand j'étais petit, c'était les tout premiers livres de Philippe Djian, 37°2 le matin notamment, qui véhiculait une ambiance particulière qui m'avait beaucoup séduit. Et à partir de là, j'ai lu un bon nombre d'auteurs américains comme John Fante, Bukowsky, toute la beat generation en fait. J'avais très envie d'écrire de raconter de grandes et belles histoires de road-movies, qui se passaient forcément aux Etats-Unis à cause de la beat generation. Sauf qu'à l'époque, j'avais 16 ans, je n'avais absolument pas vécu, je n'avais rien à raconter donc c'était ridicule.
J'avais quand même fait des nouvelles, je m'étais lancé, remporté un petit concours de nouvelles dans mon lycée. J'avais toujours ce désir d'écrire.
Et en première année de médecine j'ai rencontré mon pote Christophe Debien et on s'est mis ensemble à écrire, parce que Chris est un fondu des défis et qu'il m'avait mis au défi d'écrire un scénario pour Casus Belli.
On s'est donc mis à écrire comme des forcenés jusqu'à ce qu'ils nous acceptent et là, j'ai pu trouver un exutoire. On avait des deadlines, on devait écrire tant de scénarios pour telle date, on avançait. C'était une forme d'écriture qui n'était pas satisfaisante du point de vue de la narration, mais en tout cas, pour ce qui était d'exercer son imagination et d'écrire une histoire, c'était déjà ça ! Je ne pouvais pas espérer mieux à cette époque-là.
N. : As-tu rencontré des difficultés particulières en écrivant ce premier roman, des difficultés que tu n'aurais pas rencontrées lors de tes précédents travaux littéraires ?
P.B. : C'est une bonne question et personne ne me l'a jamais posée. Oui, il y en a eu plusieurs. La première difficulté, c'est simple, c'était le souci du détail et le réalisme. Comme je suis un maniaque du scénario bien articulé, je voulais absolument que mon historie se tienne et que toutes les boucles soient bouclées. Ca impliquait une connaissance du terrain et des lieux que je voulais décrire et j'ai donc dû aller plusieurs fois sur place.
Ce n'est pas pour rien que l'histoire se passe aux Etats-Unis, c'est parce que j'avais des attaches dans la région que je décris. Je suis donc allé sur place à Santa Monica, j'ai harcelé les bibliothécaires jusqu'à ce que j'obtienne les bons documents. C'était en pleine élection de Bush en 2004 et la bibliothèque municipale de Santa Monica était l'endroit où avait lieu le recueil des bulletins. L'endroit était complètement saturé, c'était le tour final des élections. Kerry et Bush étaient au coude à coude, et c'était l'enfer sur place.
J'ai exhumé des archives, des coupures de presse sur des choses qui ont eu lieu 23 ou 24 ans auparavant à Santa Monica. Je ne pouvais les obtenir que là, ces documents n'existent pas sur internet. J'étais arrivé là de fil en aiguille en menant une petite enquête sur place auprès de différentes personnes et j'ai finalement pu exhumer les livres sur le sujet. C'est un des obstacles majeurs que j'ai rencontré.
Il a aussi fallu convaincre la police du Nevada de m'emmener ou de me laisser aller dans certains endroits dans lesquels on n'a normalement pas accès, par exemple dans des mines. Ca a été plus facile que ce que j'aurais cru, car les gens sont étonnement sympathiques. Même chose pour un grand hôtel de Los Angeles dont j'ai vu des parties qui normalement ne sont pas ouvertes au public. J'ai bénéficié d'un accueil formidable alors que je ne suis pas arrivé avec une quelconque accréditation. J'ai seulement expliqué que je voulais écrire un thriller qui se passait chez eux.
J'avais choisi mon intrigue à l'avance mais les détails techniques que j'ai pu voir sur place ont modifié l'histoire, qui s'est nourri de mon enquête sur place.
C'était donc une difficulté d'aller sur place, mais je l'ai fait en plusieurs fois, ça s'est très bien passé et ça reste un grand moment pour moi.
N. : Tu as souvent travaillé à deux ou plus, lorsque tu écrivais des scénarios pour Casus Belli notamment. Tu penses écrire un jour un thriller à 4 mains ?
P. B. : Non. Ce n'est pas possible parce que je mets trop d'humain et de personnel dans une histoire.
Avant tout, j'adore les histoires bien tournées, je tiens à ce que le scénario soit de préférence compliqué mais surtout bien trouvé. C'est capital pour moi parce que je suis toujours déçu dans un film quand la fin tombe à plat ou qu'on devine trop vite les choses.
Ca, à la rigueur, c'est quelque chose qu'on imagine de concevoir à plusieurs. Mais sûrement pas le côté émotionnel qu'on injecte dans le livre parce qu'on ne peut espérer toucher les gens qu'en étant sincère, en se dévoilant, en mettant de ses propres faiblesses.
Ces faiblesses de l'auteur et dont il doit nourrir son livre vont être plus intéressantes que le fait de rendre des héros extraordinaires ou de montrer leurs côtés fabuleux. C'est beaucoup plus intéressant de parler de ses défauts, de ses erreurs, de ses doutes, de ses faiblesses, de tous ces côtés humains qu'on peut avoir soi-même et qu'on peut glisser dans plusieurs personnages. C'est ça qui va donner un aspect humain au livre et qui est difficilement partageable à deux.
J'aimais ça dans les livres de Djian et de la beat generation qui sont toujours écrits à la première personne : ils racontent les difficultés, des galères. J'aime aussi ça chez des écrivains comme Douglas Kennedy, ou Harlan Coben. C'est ce qui me touche, ce que je veux faire ressentir et j'ai envie de partager avec mes lecteurs : les galères et les réactions de monsieur et madame tout le monde plongés dans une situation extraordinaire. Pour ça j'ai besoin de rentrer dedans, et ça ne peut pas être écrit à 4 mains.
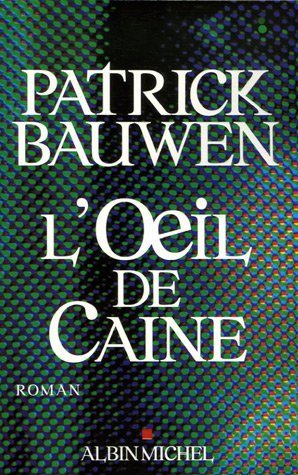 N. : L'Oeil de Caine raconte l'histoire de dix personnes sélectionnées pour participer à un reality show et qui se retrouvent prises au pièges d'un psychopathe et livrées à elles-mêmes en plein désert. Ton livre évoque de nombreuses références littéraires (on peut penser aux Dix petits nègres), télévisuelles (Lost) ou cinématographiques (le film Identity)…
N. : L'Oeil de Caine raconte l'histoire de dix personnes sélectionnées pour participer à un reality show et qui se retrouvent prises au pièges d'un psychopathe et livrées à elles-mêmes en plein désert. Ton livre évoque de nombreuses références littéraires (on peut penser aux Dix petits nègres), télévisuelles (Lost) ou cinématographiques (le film Identity)…
P. B. : Je vais te livrer un scoop que personne ne connaît : c'est en voyant le film Identity pour la première fois que j'ai eu l'idée de départ de ce livre. Parce que pendant le film, je n'ai pas arrêté de carburer, en me disant « et si c'était ça, et si c'était ça, et si c'était ça… ».
Finalement, j'ai été déçu par la fin, je trouve que c'est un film sympa mais ça ne m'a pas ébloui. Par contre m'est resté pendant un long moment ce raisonnement : on est plongé dans une situation invraisemblable, qui ne peut pas arriver, donc quelle est l'explication.
Cette scène là est directement reprise dans la première scène du réveil après l'accident dans laquelle Tom Lincoln se demande ce qu'il se passe, pourquoi il est le seul à comprendre et le seul à avoir des indices que les autres n'ont pas. Il essaie alors d'émettre une série d'hypothèses. Si j'ai mis ça dans cette scène-là, c'est parce que ça retransmettait mon état d'esprit en ayant vu le film Identity.
N. : Toutes ces références, tu les revendiques donc totalement ?
P. B. : Oui, tout à fait. Je suis issu de la génération série télé. Ca a commencé avec Dallas quand j'étais tout petit, une série dans laquelle les personnes livrées au turpitudes de leurs voisins sont obligées de réagir, et c'est ça qui nous avait tous fascinés. Les méchants sont toujours plus fascinants que les gentils, c'est d'ailleurs pour ça que tous les personnages ont un côté méchant.
Je revendique complètement les références aux séries télé, et l'influence du cinéma est également flagrante. Pourquoi hésiter à se payer un décor, des explosions, des figurants, des couchers de soleil dans le désert du Nevada… vu que ça ne coûte rien de le faire dans un livre. C'est gratos, les effets spéciaux ne sont pas chers du tout, donc pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas ? (rires)
N. : Ton livre contient donc énormément de références aux séries télés (Dallas, 24, Les Contes de la crypte, et j'en passe), aux films (de Bruce Lee à Usual Suspects), à l'univers musical des années 80-90, et tu vas même jusqu'à citer des marques, ce qui est assez rare dans des romans.
P.B. : Tout ça, c'est complètement volontaire. Rien n'est pas calculé ! Tout est millimétré (rires). Il s'agit de références volontaires pour pouvoir rentrer dans une histoire.
Je vais complètement à l'envers de la démarche de certains auteurs qui au contraire s'acharnent à ne pas situer leur livre dans le temps pour le faire durer plus longtemps, comme ça si on le relit dans 5 ans il ne fera pas "daté". Moi, pas du tout, je veux que mon roman soit daté, pour qu'on puisse rentrer avec moi dans l'histoire.
Quand je parle de séries télé, c'est parce que j'essaie de toucher toute une génération de gens qui ont les mêmes références que moi et pour qui ça va évoquer des souvenirs d'enfance. Lorsque je fais des flash-backs dans les années 80, j'ai envie qu'ils se souviennent des mêmes musiques, des mêmes marques qu'on a découvertes ensemble. Pour qu'ils se rappellent eux aussi ce que ça leur faisait, pour qu'ils puissent réintégrer leurs propres souvenirs d'enfance.
C'est un moyen d'attirer le lecteur à soi, pour qu'on communique ensemble par le biais de références communes.
Même chose pour les musiques et les marques. C'est pour dire : « Voilà, le héros a une armoire IKEA, moi j'ai une armoire IKEA, vous aussi vous avez une armoire IKEA, on a tous une armoire IKEA chez soi donc on pourrait très bien se retrouver à sa place ». C'est une façon simple de faire passer ce genre de message-là pour s'identifier.
C'est tout un boulot, au passage, de créer des références à une culture qui soient identifiables. C'est un roman dans lequel je revendique totalement l'influence des thrillers américains, mais en même j'ai essayé de m'en démarquer parce que mon livre ne s'adresse pas au public américain. C'est un livre fait pour les Français donc je dois utiliser des références qui sont lisibles pour le public français. Les Américains ou les Anglo-saxons en général ne se préoccupent pas du tout de savoir si on connaît leurs marques, leurs références, et très souvent — je pense en particulier au livre que je lis en ce moment, Lunar Park de Bret Easton Ellis —, il y a un tas de références culturelles américaines qui sont totalement impossibles à identifier pour nous. Si Bret Easton Ellis raconte qu'un gamin est habillé typique de la génération Abercrombie, ça ne veut rien dire pour un Européen, ou du mois un Français. C'est un style qui ne correspond à rien chez nous.
Il fallait donc que j'utilise des références internationales qui soient lisibles dans notre langue et qui veulent tout de suite dire quelque chose, tout en correspondant quand même à la culture américaine. Idem pour tous les travers de personnalités américaines, les expressions toutes faites ou un tas de choses que les Anglo-saxons ne prennent pas la peine de nous expliquer. A chaque fois j'ai utilisé une approche française de façon à ce que ce soit lisible et parlant pour nous. Ce qui n'est pas le cas dans la littérature anglo-saxone, où on rate toutes ces références voire on les perd à la traduction.
 N. : Tu situes donc l'action de ton roman aux Etats-Unis. La première partie de ma question, c'est de savoir pourquoi. La seconde, ça serait de te demander si tu imagines que tu aurais pu écrire un roman similaire se déroulant en France ?
N. : Tu situes donc l'action de ton roman aux Etats-Unis. La première partie de ma question, c'est de savoir pourquoi. La seconde, ça serait de te demander si tu imagines que tu aurais pu écrire un roman similaire se déroulant en France ?
P. B. : Je situe l'action aux Etats-Unis, parce que j'ai pas mal d'attaches là-bas comme je l'ai dit tout à l'heure, et que j'y passe une partie de l'année. Pour moi, c'est donc plus facile.
C'est intéressant, parce que pendant longtemps j'ai été passionné par l'héroïc fantasy, le médiéval fantastique. Et les Etats-Unis, c'est un peu mon héroïc fantasy. Ca me permet de décaler l'histoire et de lui donner une dimension épique en la rendant plus forte.
Autre raison, l'histoire ne se passe pas en France parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a des parts de moi dans ce premier livre et que c'était difficile de situer les choses près de moi. De la même façon qu'il n'est pas évident d'écrire un premier livre à la première personne et de se livrer complètement, ça m'a permis de mettre un degré de décalage supplémentaire de manière à entrer énormément de choses dans chaque personnage, qu'il s'agisse d'expériences que j'ai vécu directement, ou que mes patients ont vécu.
N. : Au départ, je pensais que tu avais choisi les Etats-Unis, par rapport aux contraintes géographiques imposées par ton intrigue. Trouver un endroit isolé ou un désert en France, c'était moins facile…
P. B. : Oui, ça l'aurait moins bien fait… L'Oeil de Caine à la Dune du Pila… C'était possible, remarque… mais moins glamour (rires)
J'ai eu une discussion comme ça avec une journaliste qui m'avait posé la même question et qui m'avait demandé si mon deuxième livre se passerait en France. C'est tout simple : imaginons qu'on veuille écrire une histoire qui se passe dans les marécages. Si c'est le marais poitevin, il y aura des sangliers, et voilà… Si ça se passe en Floride, il y aura des alligators et des hovercrafts qui foncent sur l'eau et des panthères : c'est quand même plus sympa, niveau imagination.
Mais d'un autre côté, les sangliers, c'est sympa aussi… Mais là encore, moins glamour :)
N. : Parlons un peu de ton futur au niveau littéraire… Tu penses écrire toujours des thrillers ? Je te demande ça, parce que, comme tu le disais, tu étais au départ plutôt attiré par l'héroïc fantasy, et malgré ça Chris et toi vous êtes tous les deux orientés vers le thriller.
P. B. : Le thriller est pour moi un vrai moyen d'expression. Un moyen de faire tourner les pages, comme le font d'ailleurs les séries télé. Je prends l'exemple de Desperate Housewives : ça parle de voisinage, des problèmes de cœur d'un groupe de femme, de la vie de tous les jours, mais le mode narratif reste le thriller et c'est pour ça qu'on regarde des séries. Des problèmes qui pourraient paraître banals, triviaux, deviennent passionnants parce que le mode narratif est celui du thriller.
C'est donc pour moi un vrai mode d'expression. Ce sera le cas pour celui que je suis en train d'écrire, même s'il ne s'agira pas nécessairement d'une histoire criminelle. D'ailleurs, je ne me range pas dans la catégorie polar, mais plutôt suspense.
N. : C'est donc ça qui t'attire : cette capacité de scotcher le lecteur, lui faire tourner les pages, l'emmener où tu veux.
P. B. : Exactement, c'est ce qui me plaît. D'autres auteurs font d'ailleurs ça dans un genre totalement différent. Par exemple, Guillaume Musso écrit de superbes histoires d'amour avec des rebondissements, ce qui permet de donner une dimension intéressante à ses histoires. C'est également l'aspect "page-turner", tourner les pages…
Il y a tout un travail pour maîtriser cette méthode. Rien n'est laissé au hasard là dedans. On peut étudier tous les auteurs qui utilisent cette technique, voir toutes les recettes qu'ils utilisent, se les approprier, et les réutiliser pour arriver à ce que cela paraisse invisible quand on les emploie. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, mais c'est ce qui fait qu'on lit un livre d'une traite.
N. : C'est intéressant, parce que pour beaucoup d'auteurs, le terme "page-turner" a une connotation négative, trop commerciale.
P. B. : Oui, un aspect "pop-corn". Il faut se décomplexer par rapport à ça, on peut très bien faire les deux en même temps.
Personnellement, je l'assume complètement. Je n'ai pas de vrai message subliminal dans mes histoires. Tout ce que je souhaite c'est que le lecteur et moi, on passe un bon moment ensemble. Si dans les millions de choses que je raconte il peut en plus en tirer une partie pour lui, que ça lui serve de béquille et qu'il puisse s'en servir d'une façon ou d'une autre pour voir la vie du bon côté, alors c'est fantastique. Le seul message que je pourrais éventuellement avoir c'est qu'il faut passer un bon moment. C'est plus important que poursuivre des buts ésotériques.
Tous mes personnages essaient d'une façon ou d'une autre de s'en sortir et de tirer ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Le seul message subliminal, ce serait cette vision du "verre à moitié plein".
C'est vrai pour des livres qui peuvent paraître très noirs par ailleurs. Les bouquins de Douglas Kennedy racontent toujours l'histoire d'un personnage très humain, très simple, sans ressort extraordinaire, qui s'allonge d'une façon magistrale. Le lecteur subit sa chute et attend de voir comment il va s'en sortir. C'est réjouissant de voir qu'on peut tomber très bas et qu'il reste malgré tout de l'espoir et qu'on peut toujours s'en sortir. J'aime beaucoup cette idée.
N. : Pour terminer, tu as quelques conseils d'auteurs à nous donner ? De bons "page-turners" que tu apprécies ?
P. B. : Douglas Kennedy, Harlan Coben, Peter James. Pour les français, Maxime Chattam, incontournable. Et j'aime beaucoup Franck Thilliez et Guillaume Musso. De très bon page-turners.
Au risque de vraiment faire de la propagande de base, il faut dire que le premier page-turner c'est quand même Stephen King. Il ne faut pas oublier que pendant des années, sous le nom de Richard Bachman, il a publié des bouquins à la tonne dont le seul but avoué était de les faire vendre dans des grandes publications, dans des journaux d'ailleurs sans équivalent en Europe. Ces auteurs étaient publiés à la page, et si les lecteurs ne tournaient pas les pages, les auteurs étaient virés et ne sortaient pas de papiers la semaine d'après. C'est ça, l'invention du page-turner. Il fallait qu'ils écrivent des histoires d'épouvante, de fiction et il fallait absolument capturer le lecteur quoi qu'il arrive.
Les nouvelles d'Isaac Asimov, de Ray Bradbury, c'est exactement pareil. On n'a rien inventé.
Peut-on dire que Stephen King, c'est de la littérature pop-corn ? Oui, en un sens, c'est vrai. Mais l'objectif reste de passer un bon moment et ça n'a pas empêché King d'écrire des livres magistraux comme Différentes Saisons dans lequel il a mis beaucoup de lui-même.
On peut tenter très modestement d'approcher le talon de Stephen King. Je ne pense pas qu'on puisse lui arriver à la cheville, mais au talon, peut-être…
Polars Pourpres - 2007
